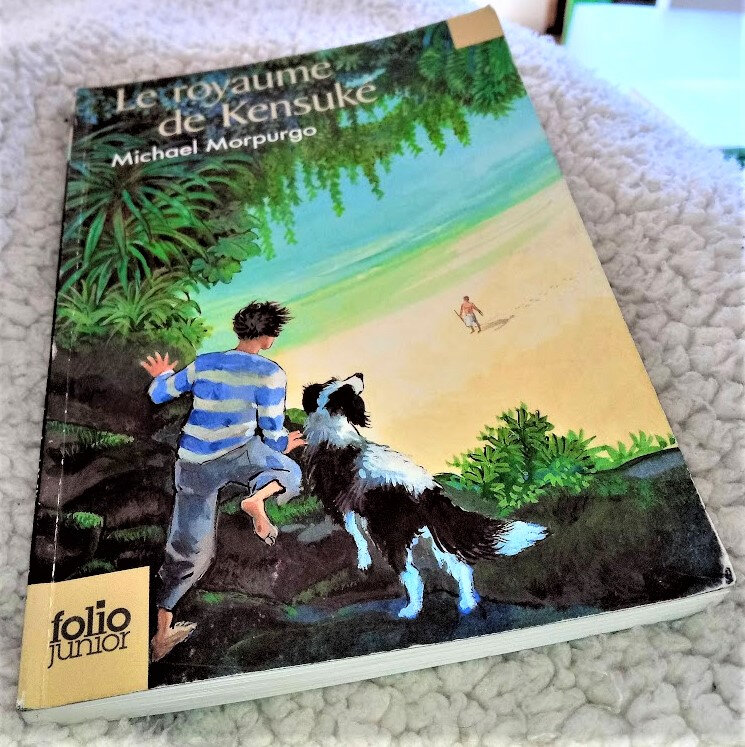Vipère au poing
Un classique que je découvre et que je ne trouve pas si facile. Disons, par rapport à ce que je m'étais imaginée. Je n'en connaissais en fait que certains extraits, glanés çà et là dans certains manuels scolaires. Je les trouvais vifs, au style enlevé, de petites scènes de vie très réussies, notamment la suivante :
"Mme Rezeau se contint jusqu'au palier. Mais là... les pieds, les mains, les cris, tout partit à la fois. Le premier qui lui tomba sous la patte fut Cropette et, dans sa fureur, elle ne l'épargna point. Notre benjamin protestait en se couvrant la tête :
"Mais, maman, moi, je n'y suis pour rien."
Petit salaud qui l'appelait maman ! Folcoche le lâcha pour se ruer sur nous. Remarquez que, d'ordinaire, elle ne nous battait jamais sans nous en donner les motifs. Ce soir-là, aucune explication. Elle réglait ses comptes. Frédie se laissa faire. Il avait un chic particulier pour lasser le bourreau en s'effaçant sous les coups, en le contraignant à frapper à bout de bras. Quant à moi, pour la première fois, je me rebiffai. Folcoche reçut dans les tibias quelques répliques du talon et j'enfonçai trois fois le coude dans le sein qui ne m'avait pas nourri. Evidemment, je payai très cher ces fantaisies. Elle abandonna tout à fait mes frères, qui se réfugièrent sous une console, et me battit durant un quart d'heure, sans un mot, jusqu'à épuisement. J'étais couvert de bleus en rentrant dans ma chambre, mais je ne pleurais pas. Ah ! non. Une immense fierté me remboursait au centuple.
Au souper, papa ne put ne pas remarquer les traces du combat. Il fronça les sourcils, devint rose... Mais sa lâcheté eut le dessus. Puisque cet enfant ne se plaignait pas, pourquoi rallumer la guerre ? Il trouva seulement le courage de me sourire. Les dents serrées, les yeux durs, je le fixai longuement dans les yeux. Ce fut lui qui baissa les paupières. Mais, quand il les releva, je lui rendis son sourire, et ses moustaches se mirent à trembler."
Cet extrait met en évidence le grand talent de Bazin pour tirer le portrait de ses personnages, en quelques lignes, quelques mots, même. Voyez les différentes expressions qu'il emploie pour désigner la mère : du froid "Mme Rezeau" à l'enfantin, mais non moins cruel, "Folcoche", sans parler de cette acerbe périphrase, "le sein qui ne m'avait pas nourri", ou de la condamnation sans appel qu'il réserve à son frère qui ose, trahison suprême, nommer cette femme "maman". Tout est dit, ainsi que l'impression qu'autour du narrateur tous se dérobent aux faits, et à la vérité. Quant à la "fierté" de l'enfant, elle se révèle, au fil des épisodes, être un désir - presque un besoin - constant de se mesurer à cette mère qu'il hait. Comme Frédie, l'aîné, répond à son frère : "Pour une fois que nous ne l'avons pas sur notre dos, fiche-nous la paix avec cette femme ! Tu gueules toujours contre elle, mais, ma parole ! on dirait que tu ne peux pas t'en passer." Et le narrateur d'écrire : "Effectivement. Jouer avec le feu, manier délicatement la vipère, n'était-ce point depuis longtemps ma joie favorite ? Folcoche m'était devenue indispensable comme la rente du mutilé qui vit de sa blessure."
J'ai l'air de m'être lancée dans une étude de texte, avec arguments et exemples, mais je voulais surtout dire que le récit du rapport entre la mère et l'enfant m'a passionnée du début à la fin, et que je l'ai découvert finalement plus subtil que ce que je croyais à la lecture de seuls extraits.
Malheureusement, j'ai découvert en même temps des passages plus retors, de nombreuses références au contexte politico-social de l'époque, qui, au lieu de m'aider à plonger dans l'univers de cette famille née d'une alliance entre deux bourgeoisies, m'ont surtout donné des complexes quant à l'étendue de ma culture historique. Je pense qu'un peu de documentation sera nécessaire avant toute relecture.
On sort de cette lecture les yeux très secs, car on découvre un personnage au caractère aussi dur que les peines qu'on lui inflige. C'est vraiment cette dureté que j'ai retenue. J'apprends à la fin de ma lecture qu'il y a une suite, La mort du petit cheval, dans laquelle le héros peine à trouver le bonheur, même éloigné de sa mère. L'éditeur écrit : "Des années de haine ne l'ont pas préparé à l'amour et il faudra qu'il fasse son apprentissage." Or, c'est vraiment de cela qu'il s'agit : un enfant tout entier modelé par la haine, et, avant tout, par la sienne, celle qu'il a éprouvée toute sa jeunesse et qu'il recrache dans les pages de son récit, comme du venin, ciselé bien sûr par la force de l'écriture. La vipère, n'est-ce pas lui aussi ?
Retrouvez la petite Mu sur son nouveau blog ! Cliquez ici.




/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F91%2F906266%2F124764840_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F70%2F906266%2F124738156_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F07%2F23%2F906266%2F117967256_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F55%2F906266%2F117653061_o.jpg)